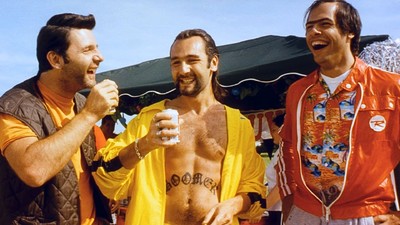La Résidence de la Fémis a 10 ans
En lien avec une programmation spéciale sur Brefcinema (10 courts métrages en accès libre à toutes et tous durant un mois), nous avons interrogé Florence Auffret, responsable du cursus de la Résidence de la Fémis, qui fête cette année sa première décennie d’existence.

Quelles ont été les circonstances de la création de la Résidence de la Fémis en 2015 ? Comment avez-vous été amenée à en prendre la direction ?
En 2014, Raoul Peck, président de La Fémis, et Marc Nicolas, directeur général, ont souhaité renforcer l’ouverture de l’école à davantage de diversité sociale et culturelle. L’émergence de certains cinéastes issus de ce que Claire Diao (critique de cinéma et distributrice, ndlr), a appelé la “double vague”, les interrogeait. À la faveur de sélections en festivals, on voyait arriver des “films guérillas” quasiment autoproduits, fabriqués à l’arrache, en marge des guichets traditionnels, comme Donoma de Djinn Carrénard (sélectionné à l’ACID à Cannes en 2010, lauréat du Prix Louis-Delluc du premier film en 2011) ou Rengaine de Rachid Djaïdani (présenté à la Quinzaine des réalisateurs et Prix Fipresci à Cannes en 2012).
Pour réfléchir aux modalités de cette ouverture, la direction de la Fémis s’est rapprochée d’Aïcha Belaïdi, dont le festival “Les Pépites du cinéma” s’était donné comme objectif de mettre en avant ces films atypiques dans leur fabrication, portés par des cinéastes amateurs souvent issus de l’immigration et des quartiers prioritaires, grandis en France dans une double culture. Aïcha organisa alors des rencontres entre la direction de l’école et des associations socio-culturelles en lien avec ces jeunes : 1000 Visages, Tribudom, Talents en Court, Cinébanlieue.
La Résidence est le fruit de ce premier travail : un programme de formation parallèle au cursus principal devant permettre à de jeunes cinéastes autodidactes de se former à la réalisation pour se professionnaliser, se constituer un réseau et accélérer leur accès au milieu du cinéma.
Fin 2014, je venais pour ma part de fermer ma société de production, Les Films de la Grande ourse. Mon profil de productrice ayant contribué pendant vingt ans à faire émerger de jeunes cinéastes et à les accompagner dans leurs premiers films intéressait l’école, qui m’a proposé d’encadrer La Résidence, lancée en avril 2015.

Little Jaffna (Lawrence Valin, 2017)
Pourriez-vous nous rappeler à qui s’adresse le dispositif et détailler ses modalités d’intégration ?
Il s’agit d’une formation à la réalisation d’une durée de deux ans à plein temps. Sans prérequis scolaires, elle s’adresse à de jeunes réalisateurs/trices de 22 à 32 ans, issus de milieux modestes et pratiquant le cinéma en amateur avec déjà une ou plusieurs réalisations à leur actif.
Ils ou elles accèdent à l’école via un concours spécifique, sur dossier artistique, notamment un récit autobiographique et une précédente réalisation qui ne doit pas avoir bénéficié de financements cadrés. Ils ou elles doivent remplir un dossier social qui conditionne le versement d’une bourse de vie pendant la durée de leur scolarité. Les candidats éligibles aux autres concours de l’école ne peuvent pas postuler à la Résidence.
L’objectif est de réunir chaque année quatre personnalités dont les parcours, les expériences de vie, et leurs premières tentatives de faire des films sont déjà porteurs de promesses, de récits ou de regards singuliers. En leur permettant d’acquérir ensuite des outils, la grammaire et le vocabulaire propres à la mise en scène de cinéma, la formation va les accompagner dans leur volonté d’expérimenter tout en se professionnalisant.

Pema de Victoria Neto (2022)
Quelles sont les grandes caractéristiques de cette formation et en quoi diffère-t-elle des cursus classiques de l’école, notamment en termes de création artistique ?
C’est une formation courte : deux ans seulement, dédiés uniquement à la réalisation, avec un effectif de quatre étudiants par promotion. Pour rappel, le cursus principal dure quatre ans pour la plupart des départements, il forme à onze métiers du cinéma et accueille six personnes par département, soit une soixantaine d’étudiant(e)s novices chaque année.
Pour la Résidence, le format est bien plus envisageable pour des jeunes souvent réfractaires au système scolaire et qui n’envisageraient pas de revenir à l’école pour quatre ans d’études. Quand ils/elles arrivent en début de scolarité, on sent chez certains une nécessité presque vitale d’être là, de faire leur film. Ils/elles sont pressés…
Le programme pédagogique a beaucoup évolué depuis dix ans, on est passé de neuf mois en 2015 à deux ans depuis 2022. En renforçant les apprentissages à l’écriture, à la dramaturgie, à la mise en scène, notamment le découpage et la direction d’acteurs. En première année, un stage professionnel de six semaines est effectué.
En deux ans, trois courts métrages sont écrits, dont le dernier est réalisé dans des conditions similaires aux films de fin d’études des “quatrième année” du cursus principal.
Faute de temps, il y a moins de théorie, mais beaucoup d’exercices de mise en pratique, certains en commun avec les étudiants des autres cursus. Les intervenants pédagogiques sont les mêmes professionnels que pour le reste de l’école.
Les références des résident(e)s se situant plutôt du côté du cinéma américain contemporain et des séries, ces deux années leur permettent de s’ouvrir à d’autres cinématographies, voire de découvrir notre propre cinéma. C’est important, car on constate souvent une forme de défiance vis-à-vis du cinéma français dans lequel les résident(e)s ne se reconnaissent pas, le considérant souvent comme trop parisien ou trop “bourgeois”…

Rabinar de Salomé Da Souza (2021).
Même s’il est sans doute délicat de distinguer tel ou tel nom parmi la quarantaine de jeunes artistes passés par le dispositif, y a-t-il des films et/ou des personnalités qui se sont révélées particulièrement marquant(e)s, notamment dans les festivals ou à la télévision ? Certain(e)s élèves ont-ils/elles déjà accédé au format du long métrage ?
Ce qui est frappant, c’est la grande diversité des univers et des esthétiques. Sur les 36 films réalisés, certains se sont bien sûr distingués en festivals et les diffuseurs : Canal+ surtout, mais aussi Arte, en ont acheté plusieurs.
Il y a des films de genre, ou qui s’y rattachent. Le genre permet d’aborder des obsessions personnelles sans trop se dévoiler, j’y vois une forme de pudeur : le polar pour Lawrence Valin (Little Jaffna) et Wissam Bentikouk (Mourir à Oujda) ou le mélodrame pour Salomé Da Souza (Rabinar).
Avec une grande sincérité, certains récits vont puiser de manière très littérale dans la vie et l’intimité de leurs auteurs. Parmi ceux-là, Espoir de Nixon Singa, Dans tes yeux morts d’Arthur Beaupère, Pema de Victoria Neto, Je pars crever de Jordan Brandao Rodrigues ou, plus récemment, Zampano de Teilo Quillard, sélectionné au Festival Cinébanlieue ce mois-ci.
D’autres empruntent avec inventivité à des esthétiques formellement plus radicales, par exemple Victor Boulanger ou Jean-Marie Bonny. Mathieu Morel (Aussi fort que tu peux), qui tourne beaucoup, est désormais très identifié dans les festivals LGBTQIA+ et commence lui aussi à aborder des durées plus longues. C’est vraiment réjouissant !

La meute de Jean-Marie Bonny (2019)
Comme pour les autres réalisateurs de La Fémis, accéder au long-métrage peut prendre du temps. Magnifique cadeau pour les 10 ans : on y est depuis avril dernier, avec la sortie du premier long métrage d’un diplômé issu de La Résidence : Little Jaffna de Lawrence Valin. Sans tête d’affiche, interprété uniquement par des comédiens d’origine tamoule pas ou peu connus, il a pourtant bénéficié de la Fondation Gan, de l’Avance sur recettes, de France 2 Cinéma et Canal+, des soutiens importants de ses distributeurs, Zinc pour la France et Charades pour l’étranger. Sélectionné en clôture de la Semaine de la critique à Venise en 2024, il est ensuite passé par de nombreux festivals en France et à l’étranger.
Actuellement en post-production, vont suivre L’une des leurs, le premier long métrage de Marie Rosselet-Ruiz, et celui d’Azedine Kasri, Mystik (co-réalisé avec Raphaël Quénard). Salomé Da Souza, qui s’était distinguée avec Boucan (actuellement disponible sur Brefcinema, ndlr), termine l’écriture de Mon sœur, son premier long, qui sera tourné en Camargue et s’inscrira dans la veine de ses films courts.
Il est très gratifiant de voir émerger cette “première génération Résidence” dans le paysage du long métrage français. On a tous le sentiment d’un pari réussi et qu’il faudra désormais compter avec ceux qui vont suivre.

Timoura d’Azedine Kasri (2018).
Comment abordez-vous la deuxième décennie d’existence de la Résidence et quels seront, selon vous, ses enjeux majeurs, alors que le secteur de la création cinématographique est soumis à de nouvelles donnes ?
À notre échelle, l’enjeu majeur sera de renforcer encore davantage l’inclusion de ces résidents au reste de l’école, d’inventer de nouvelles passerelles entre les cursus. L’ouverture opère maintenant dans les deux sens : il existe une vraie curiosité des autres étudiants vis-à-vis des résidents, de l’énergie qu’ils déploient pour leurs films, ce qu’ils apportent. Ça devrait faciliter des échanges plus concrets.
Pour l’ensemble du secteur, j’y vois une contribution notable au renouvellement des talents mais surtout des modèles. Une majorité des diplômés cités étaient comédien(ne)s au départ. Frustrés de se voir toujours proposer des rôles stéréotypés, ils se sont mis à écrire et à filmer pour jouer dans leurs propres films, pour proposer d’autres modèles, évoquer d’autres parcours de personnages, plus proches d’eux, qu’ils rencontrent au quotidien dans leur vie mais jamais sur nos écrans.
Hafsia Herzi le souligne dans un entretien récent : elle a réalisé son dernier film parce que l’adolescente de La petite dernière, elle la connaît dans la vie, mais elle ne l’a jamais vue dans un film… C’est une réalité, tout un pan de notre société reste encore à la marge dans nos films. C’est un enjeu majeur de s’organiser pour lui donner au cinéma, dans nos séries, la place qui lui revient.
Même après une école, faire des films peut s’avérer long et ardu. Il y a une forte sélectivité des projets aux différents guichets, la concurrence est féroce pour tous. Ce qui reste important à La Résidence, c’est de lutter contre les empêchements intérieurs. C’est montrer à celles et ceux qui sont habité(e)s par une vraie nécessité et le courage de faire qu’ils/elles sont légitimes et que nous allons les aider !
Photo de bandeau : Rageuses de Kahina Asnoun (2016).
Photo en tête d’article : séance spéciale consacrée à la Résidence à Côté court à Pantin en juin 2025.
À voir aussi :
- The Loyal Man de Lawrence Valin, disponible sur Brefcinema.
À lire aussi :
- Sur le Festival Cinébanlieue 2025.
- Les 25 ans de la Poudrière : 5 questions à Annick Teninge.