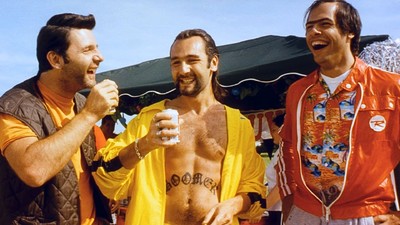États généraux du documentaire 2025 : une maison pleine de fenêtres
En cette rentrée sociale agitée, revenons par ricochet sur cet événement estival ardéchois où surprises de cinéma et échanges engagés se mêlent avec vigueur. Récits intimes bouleversés par la géopolitique, rivières, exils, soulèvements : autant de hublots déployés sur le monde.
Lussas est un village situé en Ardèche, qui compte peu ou prou deux rues et officiellement un peu plus de 1 000 habitant(e)s. C’est un endroit bien connu du milieu du cinéma. Notamment documentaire puisque, sous la houlette de la maison mère Ardèche Images, il abrite tout un écosystème dédié au genre : la Maison du Doc, soit un fonds d’archives et une base de données d’une grande richesse, des structures de production, des formations (un Master réalisation/production, des résidences), la plateforme VOD Tënk, etc. Et chaque mois d’août, de grands écrans y sont hissés en plein air ou sous chapiteau pour accueillir les fêtes et les projections des États généraux du documentaire, une semaine de festival qui orchestre une célébration du genre sous toutes ses formes. Jusqu’à cinq mille visiteurs, professionnel(le)s côtoyant sans distinction cinéphiles et curieux, se retrouvent pour partager une programmation aussi luxuriante que la nature alentour. Des films de toutes durées et issus d’un nombre vertigineux de pays, cinéma patrimonial autant que contemporain, raretés argentiques expérimentales, longs-métrages présentés en avant-premières, réalisations collectives...
Non compétitive et sans exigence d’exclusivité, la manifestation ne remet pas de prix et met plutôt fortement l’accent sur de longs temps de discussion. Un dénominateur commun vient lier les œuvres les unes aux autres, l’unité de ce bouquet varié résidant dans sa nature “engagée” – à gauche –, politisée dans son attention au monde, affirmant son attention aux voix fragiles, aux oppressions, à travers la recherche et la singularité des propositions artistiques. La notion d’émancipation plus précisément courait cette année en fil rouge d’un catalogue qui à travers deux axes thématiques mettait spécialement à l’honneur le cinéma algérien à partir des années 2010, ou l’histoire documentaire de l’Allemagne de l’Ouest dans les années 1970.
Dans un contexte d’évidente urgence face au génocide en cours à Gaza, l’équipe du festival a affirmé un positionnement clair et net en dédiant une programmation à la Palestine, tandis que chaque journée était ponctuée par un rendez-vous quotidien avec un nouveau collectif de pros : “La Palestine sauvera le cinéma.”, dont l’acte de naissance s’est affirmé dans les rues lussassoises. Constitué de travailleurs divers de l’industrie du cinéma, il appelle tous les membres de l’industrie à sortir du silence et se positionner pour un arrêt immédiat du génocide. Il est possible de consulter ici en vidéo l’intervention de l’un de ses membres, le cinéaste Eyal Sivan, en faveur d’un boycott culturel de l’État d’Israël.

Présent dans toutes les sections, le format court bénéficie d’une très belle visibilité à Lussas, présenté sans distinction parmi les longs métrages, puisque la programmation travaille aussi à proposer les films d’une manière horizontale, et à effacer toute hiérarchie entre les formats. Dans la catégorie Expériences du Regard, on retrouvait trois exemples du fameux “film de grands-parents”, sujet relativement récurrent dans le court métrage documentaire et volontiers considéré comme un marronnier, mais dont les couleurs sont portées haut par ce trio. Rappelons-le, le format court permet de produire dans une économie plus réduite, ouverte de fait aux gestes plus alternatifs, parfois réalisés hors des circuits de production classique, ou encore en école de cinéma. Tourner sa caméra vers l’espace intime de sa famille peut apparaître comme un élan naturel et compréhensible, et si tous les sujets peuvent faire cinéma, il n’est, cela dit, pas si facile de se distinguer. C’est justement un geste de cinéma très affirmé et maîtrisé qui s’exprime dans le superbe Eco, de Noémi Aubry (photo ci-dessus). Sept minutes extrêmement habitées, aussi émouvantes que précises, consacrées à la mémoire des grands-parents de la cinéaste, issus de l’immigration italienne et ouvriers dans le Grand Est, à Forbach, en Moselle, dans l’une des mines de charbon des houillères du bassin de Lorraine, soit le puits Simon 3. Réalisé à partir d’un montage d’archives en 16 mm puisées dans le fonds local du Centre des archives techniques et industrielles de la Moselle, le film articule à ces images un texte en voix off rédigé d’après les journaux intimes du couple, livrant leur quotidien dans toutes ses nuances, la difficulté du labeur au même titre que le temps festif attendu du bal de la mine. À partir de son récit personnel, Noémi Aubry façonne ainsi un hommage subtil et bouleversant, élargi à toute la mémoire ouvrière, donnant à voir des lieux, des machines et des gestes disparus, avalés par les évolutions industrielles et économiques, sans pour autant angéliser ni taire la pénibilité du travail.

Dans Chère Louise (photo ci-dessus), Rémi Brachet utilise l’espace-temps de son film pour imaginer la suite d’un récit inachevé, écrire sur les pages restées blanches sa version de la vie que Louise, son arrière-grand-mère, assassinée par son mari alors qu’elle n’avait que quarante-deux ans, aurait pu mener n’eût-elle été victime d’un féminicide. Ces années volées, son arrière-petit-fils en déploie ici sa version avec une grande délicatesse et autant de pudeur, permises par l’entremise d’un dispositif convoquant la fiction, la distance juste et chaleureuse de l’uchronie, soit le récit d’événements fictifs à travers un point de départ historique. La comédienne Ariane Ascaride incarne Louise dans un scénario qui l’emmène se réchauffer au soleil de vacances en Italie, où elle peut côtoyer son fils et voir grandir ses petits-enfants. Nous suivons un personnage libre, à l’image du film, dont le récit nous parvient à travers la voix off que Rémi Brachet a rédigée à la première personne, et confiée à l’interprétation de Jules Sagot (Le bureau des légendes).
Au même moment, ou à peu près, l’autrice Adèle Yon livre dans Mon vrai nom est Elisabeth (aux Éditions du sous-sol-, le récit de son arrière-grand-mère internée et accusée d’hystérie, et par la même occasion l’histoire du traitement psychiatrique abusif subi par les femmes au début du XXe siècle. On sent ces œuvres de deux auteurs de la même génération traversées par les échos du mouvement #MeToo, qui a certainement contribué à aiguiser leur attention et leur sensibilité aux biographies abimées de leurs aïeules, et à l’élan de travailler à leurs représentations.

Lisette Ma Neza a réalisé Branden (photo ci-dessus) dans le cadre de ses études à la LUCA School of Arts, située à Bruxelles. Doté du sous-titre “On leaving, living and never arriving”, ce poème collectif a été réalisé avec cinq femmes exilées politiques, dont la grand-mère de la cinéaste. Dressant le portrait entremêlé de chacune, le film s’emploie à incarner leur déracinement. Dans une forme polyphonique, rhizomique, Lisette Ma Neza tire de multiples fils visuels et sonores pour interroger les sensations qui accompagnent le départ forcé d’une terre natale et les réflexions sur l’idée de rejoindre la diaspora dans diverses parties du monde. Différents régimes d’images sont convoqués pour esquisser autant de facettes de leur vie : dessin, archives, photographie. Un beau travail, aventureux et audacieux, qui rappelle les gestes expérimentaux de la cinéaste canadienne d’origine haïtienne Myriam Charles.

Sur le sujet de l’exil politique, À vol d’oiseau, de Clara Lacombe (visuel ci-dessus) représente un très bel exemple de film réalisé dans le souci d’inclure dans sa fabrication la personne qui en constitue le sujet. Amadou D. a quitté la Guinée Conakry alors âgé de onze ans. Le récit de son exil est retranscrit à l’image par le biais de plusieurs techniques : animation plus ou moins abstraite, images super 8 et archives. De la Guinée à la Lybie, jusqu’à la traversée pour la France, Amadou est assis à la table de dessin avec la cinéaste, qui l’accompagne dans son utilisation du dessin.
Dans Les vergers d’Antoine Chapon (photo de bandeau), plusieurs régimes d’images contemporaines se mêlent pour permettre aux personnes filmées de retracer les contours de leur quartier de Damas, anéanti par l’armée de Bachar Al-Assad à l’issue d’un soulèvement populaire. En lieu et place des arbres fruitiers qui habitent leurs mémoires, sera construit un quartier moderne, Marota City. Par l’entremise d’images d’archives personnelles, ou encore d’animation 3D, le cinéma devient medium pour parcourir une cartographie mémorielle et se réapproprier un lieu intime disparu.

Un lieu intime, un repère familier, c’est ce que représentent pour certains habitant(e)s de Montréal les quelques diners à l’ancienne qui subsistent encore à Montréal et dont Jean-Baptiste Mees a capturé l’atmosphère dans La journée qui s’en vient est flambant neuve (photo ci-dessus). Tourné en argentique, sa photographie capture à merveille la tranquillité matinale teintée de mélancolie qui se dégage de ces restos populaires et mythiques, inquiétés par le phénomène de gentrification à l’œuvre.
Peuplés de signes distinctifs – les néons, la tasse de café, les assiettes bacon/œufs brouillés – leur décor fait immédiatement écho à l’imagier cinématographique d’Amérique du Nord. Attentif à l’observation des lieux autant qu’à la possibilité de rencontrer leurs habitué(e)s qui chaque jour viennent en un rituel y commencer leur journée, le film nous invite à une parenthèse apaisée, proche parente des Rengaines de Théo Jegat (photo ci-dessous), qui observait la vie d’un bistrot belge avec une tendresse toute proche.

Ce soin accordé à l’infime ou au non événementiel pourrait constituer une forme de manifeste, qui résume bien l’optique de la programmation portée par les équipes des États généraux. Lussas demeure un lieu refuge pour cultiver l’attention aux mondes, selon toutes les facettes du terme, dont la Palestine devrait aujourd’hui représenter le point de convergence.
NDLR : Ce texte engage seulement son autrice.
À lire aussi :