Paolo Gioli, artisan-démiurge (1942-2022)
Paolo Gioli, artiste d’avant-garde italien inclassable, à la fois peintre, sérigraphe (il a notamment imprimé des images polaroid sur des tissus, voir bandeau), photographe et cinéaste, est décédé au début de 2022. Moins connu que ses pairs américains (Jonas Mekas, Stan Brakhage), il laisse une œuvre colossale qu’un ouvrage publié par les Presses du réel éclaire sous de multiples aspects.
Paolo Gioli, impressions sauvages : douze études, un entretien, des textes de l’artiste, des analyses de ses films, de ses photographies et de ses travaux plastiques façonnent les contours d’une œuvre monumentale. Des “répliques” de ses différentes créations sont, de manière très giolienne, incrustées dans les textes. De la page 148 à la page 294, un album de reproductions d’œuvres de toutes natures est donné à décrypter, comme une série de textes (1).
Gioli commence à peindre vers 1960 influencé surtout, au début, par les fresques de la Renaissance italienne (il fréquente l’académie des Beaux-Arts de Venise), auxquelles s’ajoute bientôt le pop art, école qu’il découvre à la Biennale de Venise en 1964. Il se rend à New York en 1967, se familiarise avec le New American Cinema et rencontre un jeune compatriote aisé, Paolo Vampa, en transit comme lui. Une amitié indéfectible se nouera entre les deux hommes et Vampa produira les travaux de Gioli de 1969 à 2017.
De retour au pays, l’artiste débute une intense activité de photographe et de cinéaste tout en gardant dans son for intérieur, dans ses fantasmes, dans sa geste créatrice, l’univers pictural qui l’a nourri. Une même galaxie formelle contamine tout l’ouvrage où circulent et s’impriment anamorphoses, découpages, surimpressions, collages et hybridations de pigments, de pellicule argentique, de prises de vue en sténopé ; par contact en posant des images photographiques ou filmiques sur de la pellicule non exposée enroulée sur une tablette ; de chevauchements de négatifs et de positifs, de photos voilées, découpées ; d’emploi de found footage, d’effets stroboscopiques, de références plastiques qui renvoient tant à l’esthétique de la Renaissance qu’à Fernand Léger ou René Magritte, ou au pré-cinéma dont Gioli est un adepte fervent.
Ses films tranchent avec ces symphonies colorées, car ils sont presque tous en noir et blanc. Les illustrations du livre sont des métaphores du travail polysémique de l’artiste. Ses diverses œuvres figurent, entre autres, dans les institutions suivantes : Art Institute of Chicago ; George Eastman House, Rochester ; Harvard Film Archive, Cambridge ; The Museum of Fine Arts, Houston ; Minneapolis Museum of Art ; Museum of Modern Art, New York ; Musée Européen de la Photographie, Paris ; MNAM/Centre Georges-Pompidou, Paris ; Musée Étienne-Jules-Marey, Beaune ; Musée Nicéphore-Niepce, Chalon-sur-Saône, sans compter un grand nombre de galeries.

Quando l’occhio trema, 1989.
Idées, réflexions
Si chaque cinéaste expérimental constitue un cas particulier dans sa manière de nier la fiction, la narration, le montage, voir l’écran (pour les délocaliser ou les reconstruire), Gioli se distingue par une radicalité assez exceptionnelle qui génère le nœud d’un paradoxe assez fascinant. Malgré les processus complexes de la composition de ses images, la nature de leur rendu très dense picturalement, leur défilement vertical décadré, elles procurent, inexorablement, avant toute tentative d’analyse, un plaisir du regard et des sens immédiat. Ce n’est pas toujours le cas chez ses confrères des avant-gardes. Toutes ces matières riches, chaudes, soyeuses, en perpétuel mouvement induisent un “lavage de l’œil” proche de l’hypnose. Regarder les 39 films de Gioli – tous des courts métrages, Immagini disturbate da un intenso parassita (1970), avec ses 38 minutes est le plus long – produit, chez le spectateur, un trip vertigineux sans le recours à aucune substance hallucinogène. C’est, aussi, le premier manifeste visuel de Gioli où il joue plastiquement sur sa conception des écrans en abyme : cinéma et télévision ici.
Ce qu’il faut comprendre – et Paolo Gioli, impressions sauvages nous y aide –, c’est que Gioli est réfractaire à tout courant normé, à toute doxa, à toute pratique imposée et/ou académique. S’il a fréquenté la scène underground américaine comme un peu plus tard la Cooperativa Cinema Indipendente de Rome, il a travaillé en solitaire. Dans la sphère du cinéma expérimental qui nous intéresse ici, on peut affirmer que l’artiste ne cherche pas à faire école, à s’imposer avec un style donné (comme Peter Kubelka, par exemple, qui est le maître du “cinéma métrique” et dont l’œuvre s’articule autour du travail sur le photogramme), car il est à la recherche perpétuelle de nouvelles manières, procédures, pour traiter l’image – fixe ou en mouvement. Le processus créatif commence chez Gioli dès le démontage et la reconstruction des appareils de prises de vues. L’artiste évoque les raisons de son rejet de la prise de vue standard qu’il juge inadaptée à son travail : “… après avoir impressionné et confié (obligé de confier) mon premier film de trente mètres à un technicien quelconque d’un laboratoire quelconque, faisant subir au matériau vierge la punition anonyme d’un travail standard, alors que ce travail ne voudrait être ni anonyme ni inhumain, dans un lieu pourtant inhumain pour un résultat et un coût final anonyme et inhumain en revanche.” (page 320). Paolo Gioli appartient à cette catégorie de cinéastes expérimentaux qui s’attaquent au système même de production et de restitution des images (2).
Gioli tournera essentiellement avec des caméras dont il aura démonté le viseur ou grâce à des appareils qu’il a entièrement conçus comme cette tige verticale de deux mètres de haut, munie d’obturateurs verticaux, dans laquelle il insère de la pellicule qu’il impressionne en ouvrant les clapets les uns après les autres (voir note 2). Bien sûr, un travail d’assemblage (de manipulation) des images – celles que le créateur a produites ou celles relevant du found footage avec des stocks shots provenant de films divers (commerciaux, amateurs, pornographiques) – particulièrement sophistiqué, sans limite esthétique ou compositionnelle aucune, donne des œuvres quasiment sans équivalent. Tous ces matériaux sont unis grâce à une tireuse optique.

Dès son introduction, Philippe Dubois met le travail de Gioli sous l’ascendance de Claude Lévi-Strauss et de son ouvrage La pensée sauvage (1962), insistant sur la volonté de l’artiste italien de recommencer à zéro, à partir d’un monde qui a désappris tous les rouages et formules de la technicité industrielle pour essayer de retrouver les gestes initiaux de toute création (3) : “Paolo Gioli est cet artiste polymorphe, à la fois plasticien (peintre, dessinateur, graphiste, etc.), photographe (ayant exploré et redéfini des formes historiques de pratiques photographiques comme le sténopé, le photo-finish, le Polaroid, la luminescence, etc.) et cinéaste (apparenté – mais non inféodé — à ce qu’on appelle le " cinéma expérimental" ), qui depuis plus de 40 ans, n’a cessé d’aller et venir librement entre les pratiques, sans aucun cloisonnement.” (page 7). Dubois rebondit à partir de ce texte spéculatif, sur une pratique de Gioli, le sténopé, qui le caractérise parfaitement : “En prenant appui sur la vision de Film Stenopeico, je crois qu’on peut relever en particulier quatre traits caractérisant cette “esthétique sténopéique” cinématographique :
- le flou, ou plutôt, pour reprendre le très joli mot de Gioli : le “velouté” de l’image,
- l’image-tache (vs. L’image-fenêtre) : le halo de lumière et la surexposition,
- l’absence du cadre et la disparition du photogramme : le film-ruban comme continuum d’expositions,
- le (faux) mouvement de balayage vertical et la scansion-palpation obsessionnelle (hapticité cinétique).“ (page 92).
L’effet de contagion joue parfaitement sa partition ici. Gioli n’a réalisé que deux films sténopés : Film Stenopeico (1973-1981-1989, visuel ci-dessus) et Natura obscura (2013). Tous les autres films sont réalisés à la Bolex, parfois modifiée, avec des obturateurs extérieurs comme Immagini travolte dalla ruota di Duchamp (1994). De cette méthode chorale interdisciplinaire découle une difficulté pour historiciser, classer, répertorier et identifier des périodes dans l’œuvre de l’artiste, comme le souligne Giacomo Daniel Fragapane dans son texte “Les chronologies impossibles de Paolo Gioli” (pages 55 à 69). Dans “Le masque, “motif’’ et mécanique de l’œuvre de Paolo Gioli”, Roberta Valtorta pointe les voilements des images et des modèles (dont le corps, la figure humaine, la nature) dans l’œuvre de l’artiste : “Labyrinthique, rhizomatique, nourrissante pour ceux qui s’efforcent de la connaître, l’œuvre de Paolo Gioli produit une foule de possibilité de sens, toutes crédibles, aucune n’étant définitive…” (page 111).

Schermo-schermo, 1976.
Le croisement des disciplines, la contagion et la migration des formes “interdisciplinaires” suscitent un texte très inspiré à Dario Marchiori, “Formes de l’essayisme dans l’œuvre de Paolo Gioli : l’image incarnée”, qui s’ouvre par un constat éclairant : “Grâce à sa recherche esthétique personnelle et à ses procédés artisanaux singuliers, Paolo Gioli explore et croise les préoccupations de la peinture, de la photographie et du cinéma depuis une cinquantaine d’années. Tout en travaillant la spécificité de chaque médium, il a su en même temps les mettre en tension : son œuvre, parmi d’autres, montre à quel point la modernité artistique naît d’une confrontation entre les médiums plutôt que d’un repli autosuffisant et dogmatique, que le postmodernisme nous a habitué à pointer.” (page 31).
Eugenia Querci revient, dans “C’est la peinture qui m’a marqué”, sur cette plasticité picturale qui parcourt les diverses “images” dans l’œuvre de Gioli, comme nous le notions plus haut : “En réaffirmant souvent ses origines dans la peinture, Gioli souligne aussi, à plusieurs reprises, son intérêt pour les avant-gardes historiques (qu’il a connu jeune adolescent à 16 ans) : il en apprécie le côté artisanal, manuel et inventif, mais aussi l’idée d’une création libre et d’une continuité illimitée dans les différentes techniques.“ (page 141). Jean-Michel Bouhours, ancien commissaire du Centre Georges-Pompidou et grand défenseur de l’artiste italien, précise dans son texte “Sans filtre, voir Paolo Gioli” : “Une image retient son attention qui va susciter une interprétation qui elle-même produira un film. Le mot fiction peut prêter à confusion : les films de Gioli n’ont jamais comporté de trame narrative. Leur auteur propose une fabula optica qui développe ce qu’une image initiale déclenche.” (page 17).
Enfin, Marc Lenot (“Paolo Gioli, un artiste expérimental ?”, pages 43 à 53) et Érik Bullot (“Il dottor Vampa e Mr. Gioli”, pages 145 à 148) pointent deux “paradoxes”. Le premier essai apprend au lecteur que le cinéma expérimental possède une très grande légitimité comparé à la photographie de même nature totalement méprisée, elle. Bullot revient sur la rencontre, en janvier 1968 à New York, entre Paolo Gioli et Paolo Vampa et précise que non seulement ce dernier finance les projets de l’artiste mais qu’il lui verse également un salaire (4) !

Des films
Les films de Gioli ne sont pas abstraits, mais figuratifs ou plutôt “défiguratifs” si on se réfère au travail du peintre Francis Bacon dont on trouve des réminiscences dans l’œuvre du cinéaste-plasticien. Des thèmes autobiographiques (Hilarisdoppio, 1972, visuel ci-dessus ; Traumatografo, 1973) côtoient des hommages à diverses personnalités (Filmarilyn, 1992 ; Immagini travolte dalle ruota di Duchamp, 1994), à des courants esthétiques ou filmographiques (Piccolo film decomposto, 1986, est une relecture absolument passionnante des images créées par les pionniers du pré-cinéma : Edweard Muybridge, Étienne-Jules Marey, Georges Demenÿ ; Quando l’occhio trema, 1989, se veut une variation polysémique sur le fameux plan de l’œil tranché au rasoir d’Un chien andalou, de Luis Buñuel, 1929, qui revisite la filmographie du cinéaste espagnol avec le recours à toutes les techniques mises au point par Gioli. Imprégné des influences du pré-cinéma, de la peinture de la Renaissance mais également de culture pop, Gioli réalise avec Filmarilyn (visuel ci-dessous), le plus beau film sur Marilyn Monroe. Il réanime les nombreuses planches contact prises par le photographe Gerd Stern six semaines avant de décès de la star.
Là, le maître italien n’a pas filmé son sujet, mais il a longuement manipulé, monté, animé ces photogrammes jusqu’à en faire un documentaire-essai vertigineux sur l’icône. Un autre mythe du XXe siècle, John Kennedy, inspire le remarquable court métrage Children (2008). Des photos prises par Richard Avedon en 1960 avec John Kennedy, son épouse Jackie et sa petite fille Caroline, se trouvent rapidement contaminées par celles de jeunes mendiants photographiés à New York à la fin du XIXe siècle, puis des photos de victimes de la guerre du Viêt-Nam. Comme Marilyn, JFK est habité par la mort, surtout lorsqu’on regarde ces icônes à partir de périodes plus récentes où l’on connaît la tragédie de leur brusque décès. Là, on peut revenir au texte de Dario Marchiori déjà cité : “Formes de l’essayisme dans l’œuvre de Paolo Gioli : l’image incarnée”.

La dimension artisanale des recherches de l’artiste génère d’assez déroutantes créations. Des films comme lmmagini disturbate da un intenso parassita (1970) ou Ispezione e tracciamento sul rettangolo (1973) suscitent de fabuleux collages obtenus à partir des possibilités d’interactions esthétiques et visuelles de plans négatifs et positifs, de mixages et d’incrustations de supports films et vidéo alternant avec des amorces, des images filées, fixes, ou des figures géométriques.
Traumatografo (1973, visuel ci-dessous) et Quando la pellicola e’ calda (1974) s’avèrent de brillantes applications des méthodes formelles de Gioli, utilisées ici pour élaborer deux approches remarquables de la mort dans le premier et de la pornographie dans le second, par la démultiplication de l’écran, la transgression de l’enveloppe des corps et la contagion complète de la pellicule par la violence expressive des emblèmes multiformes de la mort et du sexe ainsi créés. Hilarisdoppio (1973) intègre la mémoire cinématographique aux recherches techniques, plastiques ou existentielles des autres bandes. Le travail sur le double, la symétrie, soutenu par une obsession de la graphie tissée sur une surface visuelle très chargée font de ce film une pièce maîtresse de l’art moderne. C’est aussi un film autobiographique.

Film Stenopeico (l’uomo senza macchina da presa) (Film au sténopé [l’homme sans caméra]) 1973-1981-1989, est certainement le manifeste esthétique de Gioli. C’est aussi un des rares films en couleurs, avec le brillant Schermo-Schermo (1978) tourné en Super 8 et qui constitue un véritable répertoire de l’esthétique giolienne, mélange de supports, travail sur diverses échelles d’écrans ; une des obsessions du “maître“. La prise de vue au sténopé se fait dans Film Stenopeico sans viseur, tactilement. L’unité même du cinéma, le photogramme, disparaît ; on a un flot d’images qui coulent verticalement, alors que tous les films de l’histoire du cinéma nous proposent un cheminement – narratif ou non (Wavelength de Michael Snow, 1967, par exemple) – horizontal.
Le travail sur pellicule non cadrée a été utilisé par des cinéastes d’animation comme Norman McLaren dans Begone Dull Care (Caprice en couleurs, 1949), qui peignait et grattait directement sur la pellicule. Mais Gioli est probablement le seul à utiliser un écoulement d’images (réelles, obtenues par l’exposition des sujets et motifs à la lumière, et non dessinées) qui se chevauchent, pulsent et conduisent le spectateur à la limites de sa capacité de perception obtenue par une prise de vue tactile, haptique.
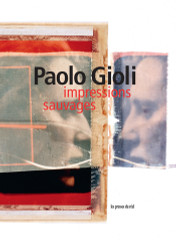
1. Paolo Gioli, impressions sauvages, Les Presses du réel, édité par Philippe Dubois et Antonio Somani, avec Enrico Camporesi et Éline Grignard.
Textes de Philippe Dubois, Jean-Michel Bouhours, Dario Marchiori, Marc Lenot, Giacomo Daniele Fragapane, Marco Bertozzi, Philippe Dubois, Nathalie Boulouch, Roberta Valtorta, Marco Senaldi, Eugenia Querci, Érik Bullot, Anne Cartier-Bresson et Paolo Gioli.
Édition française : 2020, 440 pages, 40 euros.
2. Gioli intervient sur les appareils qui produisent l’image (photo ci-dessous). Les pratiquants de l’Expanded Cinema (cinéma élargi) transforment, eux, le rendu visuel de la projection. Dans Line Describing a Cone (Anthony McCall, 1973), il n’y a plus de film à projeter. C’est le faisceau lumineux même de la projection, dans un lieu sombre, qui est l’objet mouvant et en expansion de cette œuvre. Les spectateurs doivent tourner le dos à l’écran et suivre l’évolution du faisceau qui devient un cône lumineux dense.

3. Stan Brakhage qui pratiquait un cinéma très différent de celui de Paolo Gioli avait tenté, en 1963, dans un essai, Metaphors on Vision, de définir une vision non perspectiviste créée par un œil non éduqué, celui d’un enfant par exemple : “Imaginez un œil non régi par les lois humaines de la perspective, un œil non prévenu de la logique compositionnelle, un œil qui ne répond pas au nom de tout mais qui doit connaître chaque objet rencontré dans la vie à travers une aventure de perception“. Métaphores et visions, trad. Pierre Cams, Centre Pompidou, Paris, 1998.
4. Paolo Vampa a édité un coffret de deux DVD avec quatorze films de Gioli en 2005, Film di Paolo Gioli (éditions Minerva/Rarovideo, Rome, 2005). En 2015, sort un coffret de 3 DVD avec 37 films d’une durée de 9h20, Paolo Gioli. The complete filmworks = tutto il cinema di Paolo Gioli (Rarovideo, Rome). Il manque Quando l’occhio trema (présent dans le DVD de 2005) et Natur (2017), son dernier film.
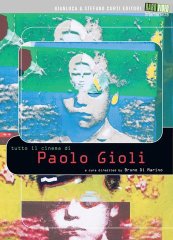
Light Cone distribue, en France, les films de Gioli (voir aussi le site personnel de l’artiste).
L’auteur remercie Enrico Camporesi et Paolo Vampa pour leur aide dans la genèse de son article.
Illustrations (sauf la couverture du livre) : © Paolo Gioli Trust.
Illustration de bandeau : extrait de la série Eakins/Marey, 1982. Composition Polaroid type 59 et transfert partiel sur soie sérigraphique. Prise de vue par contact. Sur papier à dessin, graphite, 35 x 25 cm.








