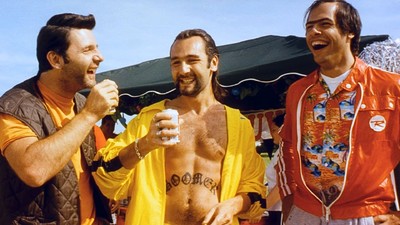“Pour Elsa” de Carmen Leroi
Dans un grand immeuble d’un quartier parisien, Elsa vit seule. Sa jeune voisine Alice l’entend jouer du piano chez elle et y prend plaisir. Elsa lui suggère d’apprendre le piano et lui propose d’en jouer chez elle, quand elle n’est pas là. Alice prend ainsi l’habitude d’occuper l’appartement d’Elsa plusieurs fois par semaine.
On entre dans Pour Elsa par une séance de méditation, délicate attention de Carmen Leroi qui prévoit pour le spectateur un palier de décompression afin de passer de la vie réelle à la vie du film. Le film se terminera sur une autre marque de bienveillance : le “C’est très bien…” adressé par un professeur de piano à sa jeune élève, Alice. Dans l’intervalle, entre les voix encourageantes de ces deux guides, le chemin de la femme mûre et de la petite fille se croisent sur le palier qu’elles partagent, puis s’écartent sans crier gare. Dans l’obscurité du premier plan, donc, la voix nous incite à nous projeter dans un paysage qui nous plait, à ce que notre corps soit ici, mais notre esprit ailleurs. Cela pourrait être une définition du cinéma.
C’est aussi le signe annonciateur de la disparition qui va frapper l’un des personnages de ce film choral. Le décor de cette grande résidence des années 1970 s’organise entre la scène des appartements et les coulisses des escaliers. Entre les portes, les personnages vont et viennent, apparaissent et disparaissent. La proximité crée des liens humains au delà de la simple coprésence. Le voisinage suffit à Elsa pour proposer à la jeune Alice de lui prêter son piano, et donc les clés de son appartement alors qu’elles ne semblent pas se connaître. Le gardien, lui, est vite excédé par Alice qui s’exerce sur son nouveau morceau, la Lettre à Élise. Ce “tube”, ce “classique”, comme l’appellent les personnages, résonne déjà dans la tête du spectateur alors que la fillette déchiffre avec une lenteur appliquée les premières notes. Il apparaîtra encore en musique d’attente de la ligne de la mairie, parodié par Anne Sylvestre dans la bouche du gardien, ou dans une majestueuse interprétation par Ivo Pogorelitch. La circulation du thème de Beethoven se fait physiquement dans l’appartement et l’immeuble, mais aussi à travers les époques, Elsa confiant à sa voisine qu’enfant, elle avait aussi appris ce morceau.
Être maintenant tout en restant celle qu’on a été est une autre façon de filer le motif d’être ici et ailleurs. Dans les photos d’Elsa et de son frère qu’Alice découvre, dans le cadeau et la carte qu’Alice trouve pour ses dix ans, c’est dans toute une famille de fillettes du même âge qu’elle vient trouver sa place, des siècles après l’Élise du compositeur dont les prénoms des deux voisines sont une sorte de contraction. Est ce qu’Elsa garde en elle la petite fille qu’elle a été lorsqu’elle disparaît ? Est-ce qu’elle continue d’habiter son appartement même en s’étant absentée ? Puisqu’il est aussi question de ce que les adultes transmettent aux enfants (les films, la musique, l’amour des animaux, etc.), on ne peut s’empêcher de penser à une lignée de cinéastes des grands ensembles dans laquelle Carmen Leroi viendrait trouver sa place. Elle utilise en effet ce topos du cinéma d’auteur pour insinuer ces questions rohmériennes du lien entre le décor et le personnage, entre comment on habite et qui on est.
Raphaëlle Pireyre
France, 2020, 30 minutes.
Réalisation et scénario : Carmen Leroi. Image : Raimon Gaffier. Montage : Louis Séguin. Son : Octave Guichard et Elton Rabineau. Interprétation : Ana Caussin, Amandine Gilbert, Maougocha Goldberg, Quentin Papapietro, Vincent Poli, Louise Racapé et Louis Séguin. Production : Association Beau temps mais orageux et Hippocampe Productions.