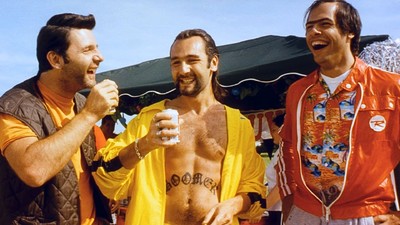“Le Grand Méliès” de Georges Franju
Précurseur de l’art cinématographique, Georges Méliès fut retrouvé, en 1928, tenant une boutique de jouets. Avant 1914, il réalisa plusieurs centaines de films féeriques et poétiques dont la fraîcheur de l’inspiration et l’ingéniosité surprennent encore les spectateurs d’aujourd’hui.
Presque soixante ans avant le distrayant, coûteux et pédagogique Hugo Cabret de Martin Scorsese (2011), Georges Franju rendait, dans un registre radicalement différent, un hommage profondément émouvant à l’un des pères du cinéma, Georges Méliès, prodigieux inventeur et révélateur de la puissance illusionniste d’un art encore naissant.
Le grand Méliès (dont on peut apprécier la belle copie restaurée) s’inscrit dans la série des courts métrages passionnants tournés par le réalisateur des Yeux sans visage entre la fin des années 1940 et le début des années 1960. Y figurent une majorité de documentaires et quelques fictions qui tous révèlent déjà ce qui fera la singularité et force du cinéaste qu’on ne saurait réduire à l’étiquette un peu vague de réalisme poétique. Il affirme alors une précision clinique de documentariste (même dans la fiction), propice à faire jaillir l’horrifique, mais aussi son goût pour l’insolite, le fantastique et parfois une magie très enfantine.
C’est naturellement vers cette dernière tendance que nous entraîne Le grand Méliès sans pour autant perdre de vue la mort qui guette et qui se présente comme toujours chez Franju comme l’envers incontournable du moindre effet d’illusion. C’est évidemment sur ce terrain-là que les deux Georges se retrouvent et dialoguent parfaitement comme le met en évidence une reconstitution d’un spectacle de Méliès dans lequel une femme découvre à travers ses jumelles de théâtre les acteurs transformés en squelettes. La beauté du film est d’étendre ce tour de passe-passe macabre à la mort même de Méliès, disparu depuis quatorze ans au moment de la réalisation du film.
La séquence d’ouverture, située dans la maison de retraite où l’artiste passa les dernières années de sa vie, est à ce titre totalement saisissante. On entre dans ce domaine comme dans un théâtre ou un studio de cinéma où l’on mesure déjà les traces laissées par la vie de l’artiste ; certaines sont invisibles, diffusées dans l’air, dans la lumière qui se reflète sur un étang du parc, d’autres sont plus cruellement concrètes comme la marque laissée par les meubles de Méliès dans une pièce qu’il occupait. Tel un prestidigitateur, Franju joue avec le temps autant qu’avec les apparences, mélangeant images d’archives et reconstitutions, documentaire et fiction auxquels il associe des membres de la famille du cinéaste, témoins, narrateurs, et pour certains acteurs. Il s’efface modestement derrière son sujet pour restituer sans emphase mais avec précision et pudeur les grandes lignes de cette existence riche et passionnée. On retrouve néanmoins son regard de cinéaste dans le magnifique dénuement de sa mise en scène propice à restituer l’empreinte artistique immense, déterminante laissée par Méliès mais aussi à saisir la marque bouleversante, mystérieuse et profonde de son absence.
Amélie Dubois
France, 1952, 32 minutes
Réalisation et scénario : Georges Franju. Image : Jacques Mercanton. Montage : Roland Coste. Musique originale : Georges Van Parys. Interprétation : Jehanne d’Alcy, André Méliès, Marie-Georges Méliès et Eugénie Méliès. Production : Armor Films.