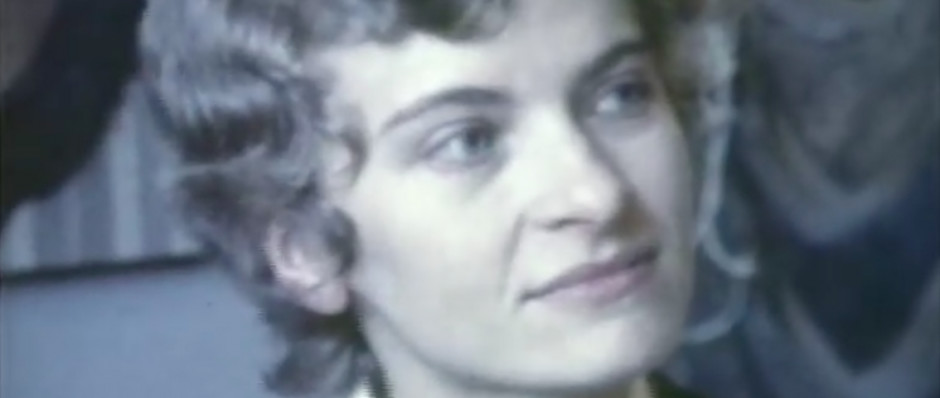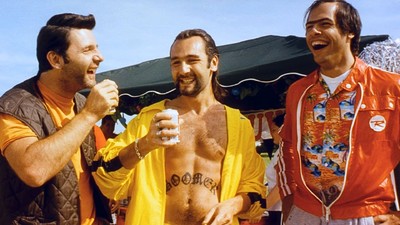“L’ambassade” de Chris Marker
“Ceci n’est pas un film ; ce sont des notes prises au jour le jour.”
Un jour de 1972 à Santiago du Chili, Patricio Guzmán vit se présenter à sa porte un homme mince. Il s’agissait de Chris Marker, qui eut ces mots : “Je suis venu au Chili avec l’intention de filmer une chronique cinématographique. Mais vu que vous l’avez déjà fait, j’aimerais autant acheter votre film pour le projeter1.” Il repartit ainsi avec le master de La première année (1971), favorisant ainsi la découverte de Guzmán en France. On sait aussi que Marker fut déterminant d’un point de vue logistique (fourniture d’une partie de la pellicule) pour la réalisation de La bataille du Chili (triptyque réalisé entre 1975 et 1979 par le même Guzmán). L’ambassade appartient évidemment à cette chronique du Chili ; des militants de gauche se réfugient dans une ambassade (on ne saura laquelle), deux jours après le coup d’État du 11 septembre 1973. Ce film et ces anecdotes disent combien Marker imagine son cinéma non comme une œuvre, mais comme un réseau de films, les siens comme ceux des autres, qu’il y collabore (comme par exemple l’écriture du texte dans … À Valparaíso de Joris Ivens, 1962) ou non. L’une des données marquantes de L’ambassade tient d’ailleurs à son énonciation ; d’une part le principe d’images en 8 mm trouvées que le cinéaste prétend reformuler, d’autre part la voix off prononcée en français avec un accent chilien, c’est-à-dire avec une autre voix que la sienne.
L’ambassade, comme souvent chez Marker, fait se rencontrer le vu – l’image – et le dit – la voix off – dans un inextricable dialogue entre le vrai et le faux, avec des effets de correspondance et autant de décrochements de sens, de contradictions, puisqu’il s’agit bien d’une mise en scène à partir d’un matériau ayant une apparence “vériste”. Comment rendre compte d’un événement, faire le récit d’une histoire alors en marche sur son versant le plus tragique ? “Déchiffrer”, “déchiffrage”, “indéchiffrable”, ces mots s’invitent dans un film dont le hors-champ s’avère véritablement obsédant. Lorsque l’extérieur entre dans le cadre, il s’agit d’une ville à l’état spectral ; ou bien carrément d’un effroi : un militant court dans la rue pour rejoindre ses camarades, il est abattu avant d’y parvenir. Dans ce huis clos suffocant, la reprise des programmes télévisés – “fenêtre” qui reste hors champ – aux mains de la junte s’accompagne de ce commentaire grinçant : “de vraies images avec de vrais discours.” Qui faut-il croire entre images et discours ? Régulièrement, le film se tait ; la caméra s’attarde sur des visages hagards, des regards perdus, des postures d’affliction. Les images muettes parlent et nous disent avec puissance l’état de perdition et de dévastation d’êtres déracinés par le vent de l’Histoire ; une forme de vérité atteinte par le truchement de la supercherie.
Arnaud Hée
1. “Ce que je dois à Chris Marker” par Patricio Guzmán, in Images documentaires, décembre 2012, n° 75/76, page 18.
Article paru dans Bref n° 108 (2013).
Réalisation : Chris Marker. Production : EFK. Distribution : Les Films du Jeudi.