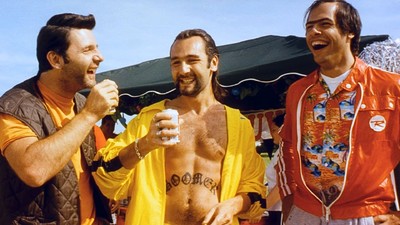“Jeunesses françaises” de Stéphan Castang
Et toi, que feras-tu plus tard ?
Des adolescents parlent face caméra, confrontés à un conseiller d’orientation peu scrupuleux que l’on ne verra jamais. Plans fixes, noir et blanc et cadre serré sur des visages en mutation, exprimant tour à tour l’amusement, la révolte, l’abattement ou la consternation. Un dispositif minimaliste que le réalisateur-comédien Stéphan Castang avait déjà expérimenté dans un film précédent, La viande, qui retraçait un entretien d’embauche cauchemardesque.
L’écriture de Jeunesses françaises, plus soignée, accentue l’ambiguïté d’une situation toujours oscillant entre documentaire et fiction. Cette voix off, grave et teintée de mépris, qui agresse et dévalorise consciencieusement les malheureux candidats, semble même inspirée de “La voix” devenue la marque de fabrique d’une certaine téléréalité. Mais ici la jeunesse et l’inexpérience ne sont pas caricaturées, même si certaines tirades chahutent le spectateur entre hilarité et perplexité : “Si on se trompe quand on est médecin, on tue un homme alors que quand on est vétérinaire, on tue un animal. C’est moins grave” (l’aspirant vétérinaire), “Les jeunes à notre époque y sont plus très bien élevés (…) dans l’avenir faut élever les enfants comme on dresse les chiens” (l’aspirante maître-chien ou brigade juvénile).
De ce mélange des genres, Castang construit une réflexion autour des rapports de force, de l’autorité et de la soumission. Qui de la jeunesse ou du représentant de l’autorité est le tyran à notre époque ? Et quelle est la légitimité du pouvoir ? Le film a l’intelligence de ne pas donner de réponse tranchée et partiale. Au contraire. En faisant participer ces adolescents à l’écriture, le réalisateur démocratise la notion de cinéma documentaire et le personnage filmé devient son propre interprète. Il est aussi l’avocat de sa défense face à ce procureur à l’attitude outrancière mais pas si irréaliste. Car si le moteur de la fiction permet de provoquer de façon grossière les lycéens en les poussant dans leurs retranchements et contradictions, leurs réponses et attitudes sont empreintes de vécu et de vérité. Malgré le jeu de rôle, les failles personnelles et familiales percent le masque de la représentation : comment exister entre l’autorité parentale et celle de l’institution ? Entre désarroi et volonté farouche, ces jeunes-là mériteraient avant tout d’être promis à une belle carrière de comédiens.
Fabrice Marquat
Article paru dans Bref n°98, 2011.
Réalisation, scénario, image et montage : Stéphan Castang. Interprétation : Gwendoline Bardot, Alexia Bertin,
Julie Cupillard, Jérémy Gaag, Soledad Grisard, Sébastien Huberté, Bastien Jorda et Cécilia Oberrieder.
Production : Takami Productions.