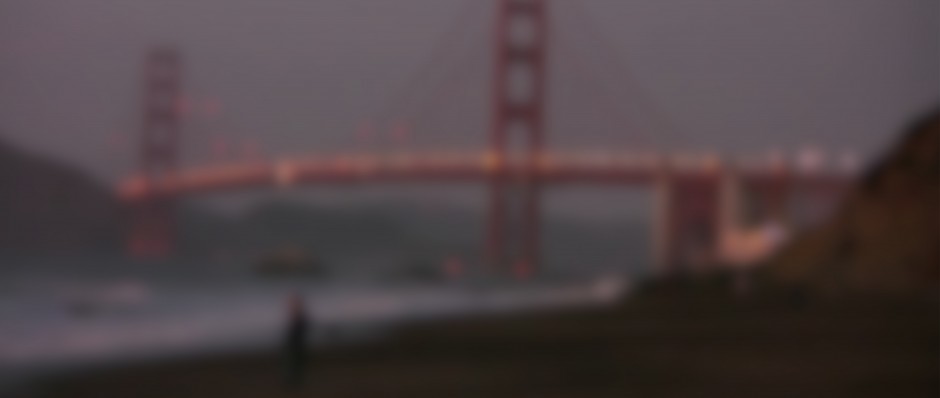“Jeunesse perdue” de François Zabaleta
À cette époque-là, on est en 78. J’ai vingt ans. Je suis en Amérique, à San Francisco.
Un homme se remémore, images à l’appui, un été de 1978 qu’il passa, à vingt ans, entre Los Angeles et San Francisco. Mais la beauté de Jeunesse perdue ne tient pas à la simple nostalgie ; elle ne vient pas forcément de la manière dont les images et la voix off font ici revivre le passé. Elle tient plutôt à la façon dont le texte – très lyrique, dit par l’auteur d’une voix grave et chaude, presque chuchotée – évoque ce que cette jeunesse aurait pu être (voire ce que cette jeunesse aurait dû être).
Le hiatus entre la mythologie californienne – convoquée à travers un plan flou du Golden Gate Bridge en ouverture, quelques noms (Greyhound, Heinz), quelques lieux (Castro Street), quelques références (le tueur du zodiaque) – et les pâles images Super 8 d’un voyage ordinaire accentuent ce sentiment mélancolique d’être passé à côté. Non seulement il ne se passa pas grand-chose pour le jeune homme, cet été-là, mais le cadre où il évoluait était parallèlement secoué par une vague contre-culturelle, par d’autres soubresauts funestes (l’apparition du Sida) dont il ne prit alors aucunement la mesure. Le romanesque et l’aventure gisent en creux du monologue. L’hédonisme et le frisson sont l’affaire d’un autre film, d’un autre voyageur peut-être, pas du jeune François Zabaleta en tout cas.
Surtout, les quatre décennies séparant les images de la voix qui se raconte ici creusent encore plus le fossé entre le présent du cinéaste (aujourd’hui) et celui du voyageur (alors). C’est avec une certaine cruauté que le réalisateur se décrit d’emblée en jeune homme au physique ingrat, galérant à Los Angeles, pourtant persuadé que les portes de l’UCLA vont s’ouvrir à lui, qu’il en a fini avec la tiède France des Seventies ou s’enferrait sa jeunesse. Il y a, dans le même mouvement du film, l’espoir d’une (nouvelle) vie qui commence, l’ennui tenace d’un séjour décevant, et la mélancolie de celui qui, à soixante ans passés, se retourne sur ce jeune adulte plein d’espoirs et d’allant qu’il était.
Mais il ne s’agit pas seulement d’opposer le présent au passé, de coller une voix off contemporaine sur des images de voyage vintage. Car ce jeune homme que le cinéaste évoque, c’est aussi celui qui filmait, celui qui se rêvait déjà cinéaste, qui essayait d’écrire une histoire, mais qui n’imaginait évidemment pas que ses images enregistrées de manière aléatoire fourniraient la matière remployée d’un beau film triste quarante ans plus tard. Cet apprenti-cinéaste, Zabaleta le malmène, le questionne, s’adresse parfois à lui pour le mettre face aux contradictions qu’il se dissimulait. Et c’est à une deuxième strate du souvenir qu’on a alors affaire. Car le passé qu’on s’écrit, celui qui rétrospectivement nous arrange (soit, en gros, les trois premières minutes du film), ce n’est pas forcément la vérité. La complexité d’un texte aux nombreux soubassements est là, dans les faux-semblants qui sous-tendent les images, dans la manière dont se diffracte ce très émouvant “portrait de l’artiste en jeune homme”.
Stéphane Kahn
France, 2020, 9 minutes.
Réalisation, scénario, image, montage, son et production : François Zabaleta.