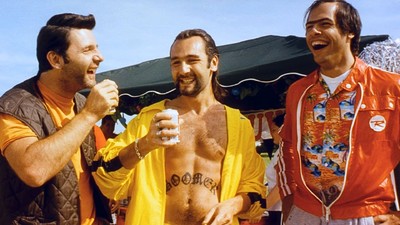"Comment Wang-Fô fut sauvé" de René Laloux
(Re)découvrez ce court d’un maître du cinéma de science-fiction à la française et des dessins signés Caza.
Comment Wang-Fô fut sauvé est le dernier film de René Laloux, cinéaste rare mais essentiel dont la filmographie s'étendit, entre courts et longs métrages, sur moins d’une trentaine d'années. C'est aussi, parmi ses films, celui qu'il disait préférer, celui qu'il considérait comme le plus achevé, d'un point de vue technique notamment. Un film qu'il réalisa dix-sept ans avant sa disparition. Et pourtant, déjà, son dernier...
Au milieu des années 1980, tandis qu'il menait enfin à bien Gandahar, un vieux projet de long métrage avec le dessinateur Philippe Caza, René Laloux créait parallèlement, avec le producteur Michel Noll, une émission télévisée dédiée au cinéma d'animation fantastique et de science-fiction. Il s'agissait, dans De l'autre côté, de montrer des courts déjà existants mais aussi d'en produire pour l'occasion. C'est dans ce cadre que fut conçu Comment Wang-Fô fut sauvé, que Laloux réalisa sur des dessins de Philippe Caza et avec une partie de l'équipe de Gandahar, en Corée du Nord.
René Laloux, animateur ne dessinant pas, poursuivait là sa collaboration avec des dessinateurs venus d’autres horizons : Caza (à la filmographie duquel il faudra ajouter La prisonnière, un autre court réalisé pour De l'autre côté mais que Laloux renia) succédait donc à Topor (qui dessina Les escargots, Les temps morts et La planète sauvage) et à Moebius (à qui l’on doit Les maîtres du temps).
Mais Comment Wang-Fô fut sauvé est, avant tout cela, une nouvelle sublime de Marguerite Yourcenar publiée en 1936 dans la Revue de Paris et reprise en 1938 dans le recueil Nouvelles orientales (on ne peut, à ce stade, que recommander le copieux livre-DVD sorti par La Traverse en 2017, qui propose à la fois la nouvelle, le film, son story-board complet et de nombreux bonus sur le cinéaste). La manière dont René Laloux adapte cette nouvelle est un modèle d'invention et de réappropriation. Où le cinéaste bouscule la temporalité linéaire du matériau d'origine en parsemant le récit principal de nombreux flashbacks. Où la narration progresse selon des points de vue diffractés (Ling, le disciple d'abord ; l'Empereur ensuite). Et où, surtout, les riches idées visuelles contenues dans le conte de Yourcenar prennent littéralement corps sous les traits de crayon inspirés de Caza et dans les merveilleux décors extrême-orientaux qu’il compose pour le film. Car Comment Wang-Fô fut sauvé, mise en abyme de l’acte de création et du regard de l'artiste, ne parle finalement que d'images. D'un réel qui ne sait être à la hauteur de ses représentations. D'un peintre dont le tort, aux yeux de ses détracteurs, sera toujours de préférer couleurs et formes à la réalité qui l'entoure. Fable sur l’art, le simulacre et les pouvoirs de la représentation, le film redouble la beauté dont il fait l’éloge par le soin porté à la lumière, aux cadres et aux décors. L’Art, in fine, y est littéralement plus fort que la mort, si bien que ce film poétique, doux et cruel à la fois, pourrait tout aussi bien faire office de manifeste esthétique.
Éternelle histoire du rêveur en butte à un monde tyrannique, alors ? Oui, sauf que l'étrangeté du film vient aussi de l'étonnante placidité de Wang-Fô (personnage ambigu qui préfère peindre la femme suicidée de Ling plutôt que plaindre son disciple). Et il faut insister sur le fait que la beauté paradoxale du film vient, contre toute attente, d’un personnage secondaire (méchant désigné de l’histoire) et de ce que ce cruel empereur est justement trop sensible, profondément mélancolique, déçu par un réel qui n'est pas à la hauteur de l'idéal plastique que lui a inculqué la contemplation solitaire, des années durant, des œuvres de Wang-Fô (“Et c'est pourquoi, Wang-Fô, j'ai cherché quel supplice te serait réservé, à toi dont les sortilèges m'ont dégoûté de ce que je possède, et donné le désir de ce que je ne posséderai pas”, écrivait Yourcenar).
Pour l'anecdote, c'est l'histrion Jean-Claude Dreyfus qui prêtait sa voix à l'Empereur. C'est donc bien là, peut-on écrire – avec le Duc d’Orléans dans L'Anglaise et le Duc d'Eric Rohmer – son plus beau rôle au cinéma…
Stéphane Kahn
Réalisation, scénario et image : René Laloux. Musique : Gabriel Yared. Voix : Jean-Claude Dreyfus et Olivier Cruveiller. Production : Revcom Télévision.