Jacques Rivette, l’art du critique
Comme beaucoup des cinéastes de la Nouvelle Vague, avant d’être reconnu comme réalisateur, Jacques Rivette fut critique et même, un temps, rédacteur en chef de la célèbre revue jaune. L’intégrale de ses textes vient de paraître. Un travail éditorial exemplaire.
Alors que, pour la plupart des principaux critiques de la Nouvelle Vague, Éric Rohmer, François Truffaut, Jean Douchet, des recueils de leurs articles ont été publiés, pour lire ceux de Jacques Rivette, on devait se reporter aux publications d’origine ou, pour certains textes, à quelques anthologies. Il ne faut pas blâmer les éditeurs pour cela ; simplement, Rivette s’y était toujours refusé. À quelque chose malheur est bon ; cette attitude nous vaut aujourd’hui, à peine trois ans après sa disparition, au lieu d’une sélection, une intégrale de ses écrits, qui inclut ceux de Arts et des Cahiers du cinéma (il y écrit de 1953 à 1969 et en fut le rédacteur en chef de 1963 à1965), mais aussi ses premiers articles dans le Bulletin du ciné-club du Quartier latin (mars 1950), animé par Eric Rohmer, ou la Gazette du cinéma (juin 1950), créée par le même Rohmer, ainsi qu’un certain nombre d’inédits, des textes de sa jeunesse à Rouen comme celui écrit après une projection du Madame Bovary de Jean Renoir ou des développements sur tel ou tel sujet, sorte de brouillons qui prendront (ou pas) forme plus tard.
Le livre s’achève sur le long entretien que Rivette avait accordé en 1999 à Hélène Frappat pour La lettre du cinéma. On peut aussi signaler, pour la bonne bouche, une discussion tout à fait passionnante autour du montage, qui réunit, aux côté de Rivette, Sylvie Pierre et Jean Narboni (Cahiers du cinéma mars 1969).
Ceux qui ne connaitraient pas ses textes les plus célèbres comme celui, à l’imposante postérité, consacré au film de Gillo Pontecorvo pourront s’en délecter : « Voyez cependant, dans Kapo, le plan où Riva se suicide, en se jetant sur les barbelés électrifiés ; l’homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n’a droit qu’au plus profond mépris. » On entendra avec profit cette analyse de ce texte par Stéphane Bou au Forum des images et on peut regarder ici le passage incriminé.
Et puis, il y a la fameuse « Lettre sur Rossellini » (Cahiers du cinéma, avril 1955) : « Il me semble impossible de voir Voyage en Italie sans éprouver de plein fouet l’évidence que ce film ouvre une brèche, et que le cinéma tout entier y doit passer sous peine de mort. » La note de présentation de ce long texte – il convient ici de signaler l’excellence de l’accompagnement éditorial, à commencer par la brillante préface de Luc Chessel – nous apprend qu’il fut écrit alors que Rivette se remettait chez ses parents de l’opération d’une boule tuberculeuse et que Rohmer déclara, quand il le découvrit, qu’il « enfonçait les portes du sublime ».
La traversée de ces textes provoque évidemment bien des impressions. Parmi celles-ci, il y a le sentiment de percevoir une sorte d’humus à l’origine de bien des affirmations dont il est difficile d’évaluer si elles émanent du climat particulier des Cahiers, des conversations échangées, ou du rôle de Rivette, à propos duquel Jean Narboni avait déclaré au moment de sa mort : « Il était pour moi un modèle absolu, le plus grand critique des Cahiers du cinéma, et il le reste d’ailleurs aujourd’hui toutes périodes confondues. Un exemple de rigueur, d’écriture, de tranchant. » Ce sont, par exemple, la détestation du cinéma anglais, la mise en avant de certains cinéastes américains au détriment d’autres. Ainsi, à propos de John Huston : « Il serait peut-être plus simple de considérer, une fois pour toutes, cet éternel ex-scénariste comme un illustrateur. » Plus profondément, la question lancinante qui sourd de cet ensemble de textes, tourne autour de la définition de la mise en scène, plusieurs fois remises sur le métier et clé de voute de ce qui fait qu’un film est un film. Cette interrogation demeure sans réponse. Elle surgit de nombreuses fois, y compris en filigrane d’une critique du classement art et essai dans les Cahiers de novembre 1960 – le débat ne date donc pas d’hier – où Rivette s’étonne de la présence de certains titres présents dans la liste et qui, selon lui, ne relèvent ni de l’art ni de l’essai. Et d’en mettre en avant d’autres, « mineurs assurément, mais infiniment moins éloignés de l’art du cinéma : Les combattants de la nuit, de Tay Garnett, Les légions de Cléopâtre, de Vittorio Cottafavi, Deep in My Heart, de Stanley Donen. »
Dans l’entretien avec Hélène Frappat, il revient une dernière fois sur cette question indémêlable : « Et quand j’ai envie de répéter “un film est un film”, c’est aussi par rapport aux critiques que l’on peut lire à gauche et à droite, parce que très souvent, il s’agit de l’histoire, éventuellement des personnages, parfois des comédiens, rarement. Mais du fait que c’est un film, c’est-à-dire quelque chose qui doit avoir une vérité de film, au sens où Cézanne parlait de la vérité de la peinture, donc une vérité matérielle (…), ça c’est quelque chose dont il est rarement question. Je veux bien admettre que c’est très difficile d’en parler avec des mots, c’est plutôt quelque chose de l’ordre de l’intuition… Il y a un sentiment que ça existe ou n’existe pas, ce sentiment-là est très arbitraire, il est très difficile de le justifier, et souvent on a envie de dire “c’est comme ça”. » Rivette boucle ainsi la boucle si on songe à une de ses formules tranchantes dont il avait le secret, celle qui ouvre un de ses premiers textes pour les Cahiers (mai 1953) : « L’évidence est la marque du génie de Hawks. »
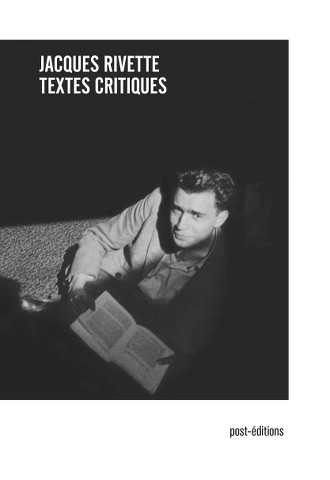 Pour ne pas conclure, parmi les textes qui nous aimerions citer, il y a celui à propos de Judex, de Georges Franju (Cahiers du cinéma, novembre 1963) : « Rien que les apparences, mais toutes dans le mouvement même de leur apparition, de leur naissance, de leur invention : secret à l’origine du cinéma, qui est ici comme sil ne s’agissait pas désormais d’un secret. Mais en même temps, notre étonnement devant lui : Franju est à la fois celui qui, par science, le retrouve, et le moderne qui le sait perdu – et s’étonnant de son pouvoir, l’épiant, l’affirmant enfin dans ce scrupule. »
Pour ne pas conclure, parmi les textes qui nous aimerions citer, il y a celui à propos de Judex, de Georges Franju (Cahiers du cinéma, novembre 1963) : « Rien que les apparences, mais toutes dans le mouvement même de leur apparition, de leur naissance, de leur invention : secret à l’origine du cinéma, qui est ici comme sil ne s’agissait pas désormais d’un secret. Mais en même temps, notre étonnement devant lui : Franju est à la fois celui qui, par science, le retrouve, et le moderne qui le sait perdu – et s’étonnant de son pouvoir, l’épiant, l’affirmant enfin dans ce scrupule. »
Jean Narboni n’a pas tort.
Jacques Kermabon
Jacques Rivette, Textes critiques, édition établie et annotée par Miguel Armas et Luc Chessel, Post-éditions, 2018, 24 euros.
Photo d’ouverture : George Sanders et Ingrid Bergman dans Voyage en Italie, de Roberto Rossellini, 1955.











